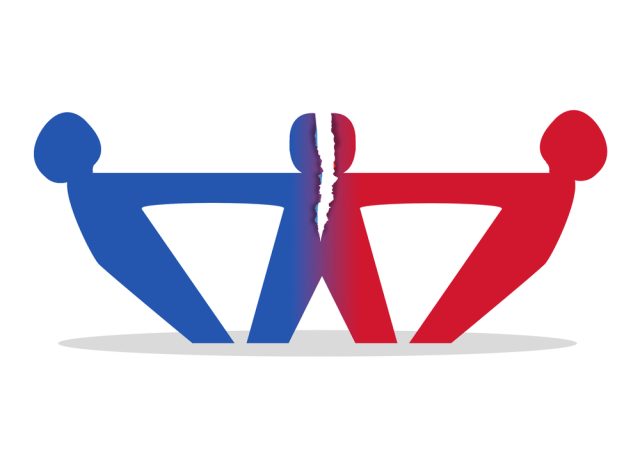
L’état de l’économie prend de plus en plus de place dans la conscience publique et dans le débat politique en Europe. Un pays après l’autre doit faire face aux conséquences de divers types de mauvaise gestion au fil des décennies, et se retrouve paralysé par le rattrapage des dettes impayées. Le dernier pays en date à faire l’objet d’une telle attention est la France, où le fragile gouvernement a été contraint de démissionner à la suite d’une crise budgétaire. Auparavant, la crise financière de la Grèce et d’autres pays méditerranéens avait mis en lumière l’instabilité de larges pans de la zone euro.
En Suède, la perspective de la crise économique qui s’approche est principalement axée sur le maintien du système de protection sociale. L’image stéréotypée de la Suède est que le système de protection sociale prime généralement sur les autres priorités financières, mais cette vision est depuis un certain temps remise en question par une tendance à la libéralisation économique qui, dans le contexte de la crise économique européenne, est à la fois en train de perdre mais aussi de gagner la partie.
La libéralisation de la Suède : de célébrée à détestée
La libéralisation de la Suède « socialiste » remonte à la seconde moitié des années 1970, lorsque la social-démocratie a définitivement perdu le pouvoir au gouvernement pour la première fois en plus de 40 ans. Mais ce n’est qu’en 2006, lorsque l’Alliance libérale de centre-droit a commencé à gouverner pendant deux ans, que l’enthousiasme pour les faibles impôts et la « marchandisation » du système de protection sociale s’est véritablement installé. Cela a introduit une concurrence entre le secteur public et les initiatives privées nouvellement lancées, ces dernières fonctionnant avec des licences gouvernementales et un soutien financier public partiel, mais avec une approche notoirement non interventionniste.
Dans les années qui ont suivi, ce système est devenu un objet de haine pour beaucoup. Le secteur privé de l’aide sociale a été le théâtre d’abus et de fraudes, en raison de mécanismes de contrôle inadéquats et de la naïveté générale des autorités. Les cliniques et les écoles privées sont régulièrement dénoncées dans les médias pour leurs normes insuffisantes ou les scandales qui ont mis en danger leurs clients. Les écoles, en particulier, ont eu tendance à être franchisées, ce qui a permis à une poignée de sociétés n’ayant guère de comptes à rendre de posséder le marché de l’éducation, suscitant des débats sur la question des profits par rapport à la population.
Le sentiment d’injustice que ce type de privatisation ou de libéralisation d’un secteur autrefois presque entièrement public a créé est bien sûr commun à la gauche. Du côté de la droite nationaliste, la question de savoir qui gère les écoles et les cliniques privées se pose de plus en plus. Pendant longtemps, les islamistes ont utilisé le droit de gérer des écoles privées avec des programmes uniques centrés sur leur vie culturelle et religieuse pour maintenir la ségrégation des musulmans en Suède et pour incuber une idéologie radicale et souvent violente. Aujourd’hui, toutes les écoles privées ayant un profil islamique ont été fermées par les autorités après que des liens avec le djihadisme (et parfois l’État islamique) ont été révélés, mais de nombreuses écoles privées restent controversées en raison de leur réputation de s’adresser principalement à des groupes religieux minoritaires particuliers, bien qu’elles soient formellement non confessionnelles.
On peut se demander ce que cette réforme, qui a techniquement eu lieu lors du bref retour des libéraux au début des années 1990 mais qui a pris toute son ampleur dans les années 2010, a signifié pour l’efficacité des secteurs de la santé et de l’éducation. Elle a peut-être facilité le degré d’austérité pour lequel les gouvernements suédois sont connus depuis quelques décennies, mais elle a également eu un coût social pour la société suédoise. Aujourd’hui, nombre de ses architectes s’accordent à dire que les entreprises privées de protection sociale doivent être freinées, voire supprimées. C’est le cas des libéraux, le parti qui a été l’un des principaux défenseurs du système dans les années 1990, mais qui souhaite aujourd’hui redonner à l’éducation sa place dans le secteur public.
Mais alors que de nombreuses « réformes de la liberté » des années 1990 sont aujourd’hui honnies par le public suédois, il existe un mouvement révisionniste naissant qui vise à mettre en avant les aspects positifs de ces systèmes débattus.
Quelle a été l’importance de la libéralisation pour l’économie suédoise ?
Après la crise du début des années 1990, la Suède a entrepris des changements à grande échelle dans son économie qui, selon certains, était surchargée par la taille du secteur public et les réglementations excessives. La privatisation, ou plus exactement l’hybridation de l’éducation et de la santé, n’est que la plus concrète des réformes entreprises. À partir de cette période, la tendance générale a été de faciliter l’esprit d’entreprise de diverses manières, ce qui a lentement érodé l’image de la Suède en tant que pays défini par un secteur public véritablement unique.
Depuis son entrée dans l’Union européenne en 1995, alors qu’elle était en position de faiblesse, la Suède est devenue à bien des égards l’un des principaux pays d’Europe, notamment dans le secteur de la technologie. En 2018, la Suède avait la deuxième plus forte densité de startups « licornes » (entreprises non cotées en bourse et évaluées à plus d’un milliard de dollars) au monde, rivalisant ainsi avec les États-Unis. D’autres entreprises numériques importantes, telles que Spotify, s’ajoutent à la liste des miracles entrepreneuriaux suédois des années 2000.
L’importance de ces entreprises, qui sont à la fois symboliques et réelles en termes de contribution économique, a été d’autant plus soulignée que la Suède s’est retrouvée au seuil d’une récession au cours des années 2020. Alors que la croissance du PIB suédois a été pratiquement stagnante ou négative au cours des dernières années, il existe un certain nombre d’entreprises très performantes qui ont défié tous les pronostics et se sont imposées même sur le marché mondial. Les défenseurs de la libéralisation des dernières décennies affirment que cela démontre la valeur de certains des actifs immatériels les plus précieux de la Suède, à savoir l’innovation et l’esprit d’entreprise. Il s’agit d’une perspective de l’histoire économique suédoise qui remonte à loin.
La densité suédoise de « génies » est une tradition qui remonte au milieu du XIXe siècle, lorsque le pays était en pleine modernisation. Les guildes commerciales, les monopoles et la diète médiévale des États ont été abolis, ce qui a déclenché un flot de créativité sans précédent qui a fait de la Suède l’un des principaux contributeurs technologiques, industriels et scientifiques au monde. Depuis lors, le pays a conservé un nombre élevé de brevets technologiques à l’échelle mondiale, très élevé par rapport à sa faible population.
Les libéraux économiques convaincus extrapolent cette vision de l’histoire suédoise pour dire que la prospérité suédoise du 20e siècle n’est pas due à la social-démocratie, mais qu’elle l’a été en dépit d’elle – c’est plutôt l’esprit d’entreprise des Suédois qui aurait porté le pays vers de grands sommets malgré tout. Ils soulignent également que les principaux acteurs du miracle suédois, de nombreuses entreprises dans les secteurs de l’acier, des machines, de l’automobile et de l’électricité, ont tous été fondés avant l’apogée de la social-démocratie. Ce n’est pas non plus une coïncidence si la Suède a entamé sa lente descente dans l’indice de richesse lorsque le pays est devenu presque synonyme de social-démocratie. Il est donc logique que les réformes des années 1990 et 2000, qui ont mis fin à une grande partie du corporatisme de la social-démocratie, aient redonné du sang neuf à l’esprit d’entreprise suédois, ce qui aide grandement le pays à se maintenir à flot aujourd’hui.
Cette perspective est intellectuellement attrayante et cohérente. Elle a également été utilisée pour comparer le développement de la Suède à celui de la Norvège, un autre État-providence scandinave réputé pour sa prospérité matérielle. En Norvège, l’industrie pétrolière contribue massivement aux fonds d’investissement publics, constituant une épine dorsale remarquablement lucrative mais passive de l’économie du pays. Cependant, depuis peu, l’incapacité supposée des Norvégiens à innover et à générer de nouvelles richesses a suscité un débat parmi les économistes et les commentateurs politiques. L’économiste norvégien Martin Bech Holte a affirmé dans un livre publié cette année que son pays était devenu paresseux en raison de la surabondance de pétrole – ce qui se produit peut-être facilement dans les pays qui deviennent trop dépendants des ressources naturelles.
Si la ressource naturelle de la Suède réside dans la créativité et l’innovation de ses habitants, la libéralisation peut sans aucun doute être considérée comme le moyen d’exploiter ce pouvoir.
Le coût de la prospérité économique
Mais comme nous l’avons déjà souligné, le mouvement de libéralisation de la Suède ne doit pas seulement être salué pour avoir redonné vie à une économie rigide et presque socialisée. Ses conséquences sociales ont parfois été carrément désastreuses, notamment en ce qui concerne sa vision de l’immigration et de la culture. Les effets irréparables des écoles et des cliniques privées commencent à se faire sentir, tout comme les effets d’une migration de main-d’œuvre non filtrée. La négligence croissante du droit du travail suédois suit ses traces, avec un déclin des normes de sécurité et des normes professionnelles évidentes pour ceux qui osent jeter un coup d’œil derrière le rideau.
C’est là que les conservateurs doivent être la voix de la raison lorsqu’ils travaillent avec les libéraux pour transformer la société. En Suède, les forces de la libéralisation contrôlent le discours sur de nombreux sujets, et l’immigration est l’un d’entre eux – mais nous ne pouvons pas laisser la sécurité et l’identité de la Suède, ou de tout autre pays européen, être asservies aux intérêts économiques. Bien qu’il soit séduisant pour de nombreux nationalistes et conservateurs de se joindre aux libéraux pour critiquer la rigidité typiquement socialiste de l’économie suédoise qui existe encore, ils doivent se méfier de ce qui est cassé et de ce qui ne l’est pas – et ne pas essayer de tout « réparer » d’un seul coup, comme cela a été tenté dans les années 1990 et 2000.



 Subscribe
Subscribe